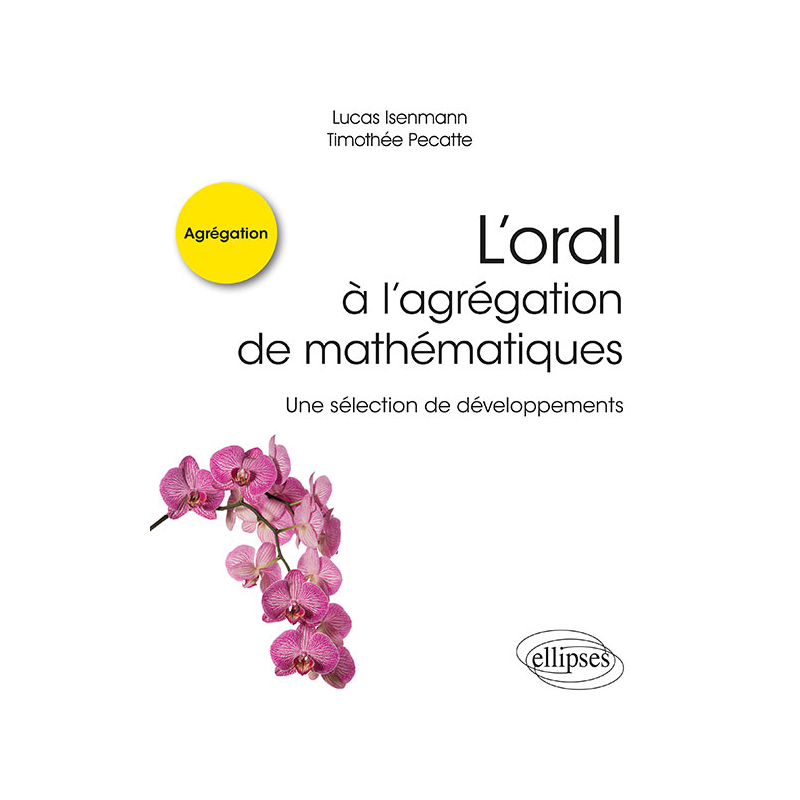Résumé de l'échange avec le jury (questions/réponses/remarques) :
Pas d’auditeur, le jury m’accueille, me rappelle les modalités et de bien m’hydrater. Ensuite, il me dit de commencer dès que je le souhaite. Je présente mon plan, je dépasse un peu malheureusement. Ils choisissent à l’unanimité le premier développement sur les endomorphismes normaux (et heureusement, le deuxième est un recasage que je trouve abusif). Ils me rappellent que j’ai le droit de consulter mes notes avant de commencer, puis j’y vais. Je démontre une série de trois lemmes avant de passer à la réduction. Le développement se passe bien, mais le jury me dit que je dois conclure juste avant la toute fin.
Concernant le développement, le jury me pose plusieurs questions :
Sur le développement :
Q : Pourquoi, quand vous écrivez le polynôme minimal de u comme produit entre un polynôme de degré 2 et un autre polynôme Q (u n’a pas de vp réelle), lorsque l’on évalue en u, on a Q(u) \neq 0 ?
R : Par définition du polynôme minimal, c’est le polynôme de plus petit degré annulant u.
Q : Quand vous écrivez le polynôme caractéristique de la matrice A de taille 2, dans le cas où elle est symétrique (on souhaite obtenir une contradiction en ayant une vp réelle), pourquoi passer par cette méthode ?
R : Effectivement, comme A est symétrique réelle, le théorème spectral nous dit qu’elle est diagonalisable de vp réelles, d’où la contradiction directement.
Q : Qu’est-ce qui se passerait si on était dans un cadre hermitien et non euclidien ?
R : J’ai eu un peu de mal à comprendre où le jury voulait en venir, j’ai répondu que dans ce cas, comme C est algébriquement clos, l’endomorphisme normal est trigonalisable. Ils m’ont dit de détailler l’étape intermédiaire entre clôture algébrique de C et trigonalisation de l’endomorphisme, j’ai bégayé sur le moment, et ils sont passés à autre chose.
Sur le plan :
Q : Pouvez-vous me donner des exemples d’endomorphismes normaux, et le cas échéant comment se passe leur réduction ?
R : J’ai d’abord parlé des endomorphismes symétriques, et leur réduction est bien connue, elle est fournie par le théorème spectral. J’ai ensuite parlé des endomorphismes orthogonaux, et leur réduction est analogue à la forme générale : la matrice diagonale n’est composée que de -1 et de 1, puis le blocs diagonaux de taille 2 sont des matrices de rotation.
Q : Quelles sont les seules vp d’un endomorphisme orthogonal et pourquoi sont-ce les seules ?
R : Au vu de la réduction et de mon instinct, j’ai répondu -1 et 1, ils m’ont donc demandé de le démontrer. Je ne voyais pas trop comment faire, et on m’a dit de revenir aux définitions tout simplement. Après quelques longues secondes de cafouillage, je parviens à donner les définitions, puis en regardant le produit scalaire de u(x) avec lui-même, on obtient bien vp^2 = 1.
Q : Pour u et v commutant, pouvez-vous donner des exemples de sous-espaces dépendant de u stables par v ?
R : Je pense aux sous-espaces cycliques, on me dit de penser plus simple, je réponds donc sous-espace propres. Je montre alors la stabilité, et le jury me fait remarquer très vite que j’avais conclu au tableau sans que je m’en rende compte.
Q : Vous donnez comme exemple que les sous-espaces stables par un endomorphisme nilpotent d’indice de nilpotence égal à la dimension de l’espace ambiant sont exactement les noyaux itérés. Comment le prouvez-vous ?
R : Montrer qu’ils sont stables est presque immédiat, le sens réciproque est plus compliqué… J’avais feuilleté la preuve avant d’aller à l’oral donc je me souvenais à peu près du schéma. On pose F un sous-espace vectoriel de E, on considère u_F l’endomorphisme induit sur F, et on doit montrer que la dimension de F coïncide avec l’indice de nilpotence p de u_F. On procède par double inégalité, le jury m’a aidé car j’avançais un peu à tâtons.
Autres questions :
Q : On considère la matrice diagonale A de taille 3, avec 1,2,3 sur la diagonale. Déterminer tous les sous-espaces stables par A.
R : J’étais un peu déboussolé, déjà par la chaleur étouffante de la journée, puis par la question puisque je préfère voir les choses via les endomorphismes. J’ai le réflexe d’énumérer d’abord ceux de dimension 1, qui sont les sous-espaces propres associés aux vp (qui sont les coefficients diagonaux), et ils me demandent si ce sont les seuls. Je réponds que oui, mais je n’ai pas le temps de le démontrer que l’oral se termine.
Mon impression globale est un peu mitigée. J’ai eu un couplage que je redoutais vraiment (j’ai fait l’impasse sur la convexité), et l’algèbre linéaire ne me plaît pas trop. Malgré tout, je pense que mon plan n’était pas horrible, mon développement était un peu long mais bien exécuté, j’ai su globalement répondre aux questions.